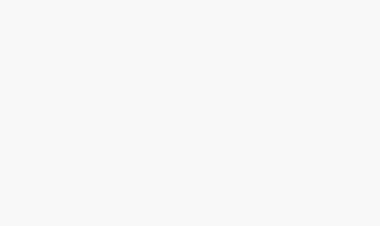Entretien avec Ibrahima MANE Journaliste et politologue Deuxième partie
«La propension du Conseil constitutionnel à se déclarer incompétent pour connaître de violations manifestes de droits constitutionnels par le législateur pose la problématique de l’instauration d’une véritable Cour constitutionnelle».

«La propension du Conseil constitutionnel à se déclarer incompétent pour connaître de violations manifestes de droits constitutionnels par le législateur pose la problématique de l’instauration d’une véritable Cour constitutionnelle».
Dans cette seconde partie de cet entretien exclusif, l’éminent juriste et universitaire revient, dans son commentaire de l’actualité politique et juridico-constitutionnelle, sur la loi très controversée du 12 février 2005 dite loi EZZAN amnistiant les assassins du juge Babacar SEYE. Le professeur El Hadj MBODJ revient également sur le vote de la loi prolongeant le mandat des députés dans le but de coupler les élections législatives et la présidentielle de 2007, et termine sur l’analyse juridique et constitutionnelle de la mise en accusation, par la majorité libérale, du Premier ministre Idrissa SECK devant la Haute Cour de Justice. Pour le professeur El Hadj MBODJ, au vu du déroulement des événements constitutionnels et juridiques sous l’alternance, il semble nécessaire d’instaurer à la place du Conseil constitutionnel dont les compétences sont très limitées une véritable Cour constitutionnelle.
Q. Que pensez-vous du vote par la majorité libérale de la loi d’amnistie du 12 février 2005 communément appelée Loi EZZAN ?
RAppelée du nom de son initiateur Ibrahima Isodore EZZAN qui en a assumé la paternité au cours de la procédure législative par le dépôt d’une proposition de loi, cette loi du 12 février 2005 traduit un malaise général. Sa fonction manifeste est d’amnistier, c’est-à-dire d’effacer de la mémoire collective l’acte crapuleux que constitue l’assassinat, dans l’exercice de ses fonctions, du juge Babacar SEYE, vice-président du Conseil constitutionnel. Ce coup de poignard à la démocratie eût lieu la veille même de la proclamation des résultats définitifs des élections législatives de Mai 1993 par le juge des élections nationales.
Avant de revenir sur les problèmes de fond que la loi soulève relativement à sa conformité avec les principes fondamentaux qui encadrent l’amnistie, il n’est pas superfétatoire de rappeler les actes qui avaient été posés par le pouvoir libéral dès son accession à la magistrature suprême. Le premier acte est la grâce accordée par le Président de la République aux assassins du juge Babacar SEYE qui avaient été condamnés souverainement par une Cour d’assises dont l’arrêt a force de vérité légale.
Le second acte est l’indemnisation par l’Etat du préjudice qui aurait été causé à la famille de Babacar SEYE, en dehors de toute base légale et au mépris des règles élémentaires régissant la transparence des opérations financières de la puissance publique.
Le troisième acte est le vote même de la loi d’amnistie qui est une prérogative exclusive de l’Assemblée nationale qui, depuis les élections législatives anticipées du 29 avril 2001, est contrôlée par une majorité libérale qui s’aligne mécaniquement sur les desiderata du chef incontesté du parti.
Le discours officiel de légitimation de la loi d’amnistie mettait l’accent sur l’exploitation politicienne de cet acte crapuleux qui ne ferait que réveiller des souvenirs douloureux pour la famille du juge SEYE. Un haut responsable du PDS est même allé plus loin, en déclarant froidement que le Président de la République avait des doutes sur la culpabilité des condamnés, foulant ainsi au pied le principe de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à toute décision judiciaire définitive.
En ce qui concerne l’articulation des dispositions de la loi, il est loisible de remarquer que les articles 1 et 2 étaient libellés en des termes contradictoires, faisant que la constitutionnalité d’un article donné entraînait par voie de conséquence l’inconstitutionnalité de l’autre. En effet, l’article 1 se caractérisait par sa généralité et, en particulier, l’indétermination du champ d’application de l’amnistie qui couvrait toutes les infractions politiques ou celles liées aux élections de 1983 à la promulgation de la loi d’amnistie. L’article 2 était au contraire plus restrictif, dans la mesure où il visait les infractions spécifiquement liées à l’assassinat du juge Babacar SEYE.
L’option était alors à lever entre la généralité et la spécificité de la loi d’amnistie, étant entendu, que le choix d’une option implique l’inconstitutionnalité de l’autre. En d’autres termes, la validation de l’article 1 entraîne le rejet de l’article 2 et vice versa. Derrière les principes généraux, il y a lieu de prendre en compte cette maxime selon laquelle une faute avouée est à moitié pardonnée, et que l’on ne saurait absoudre la faute virtuelle.
La mise en œuvre de l’article 1 de la loi du 12 février 2005 posera de sérieux problèmes au juge qui sera amené à procéder à des analyses au cas par cas, pour déterminer si chaque affaire portée devant lui entre ou non dans le champ d’application de la loi.
Prenons l’exemple de la tentative d’assassinat du leader du JEF JEL. Est-ce une infraction politique du seul fait que Monsieur Talla Sylla est un acteur politique, responsable d’un parti politique, ou bien est-ce que les agissements criminels dont il a été la victime sont détachables de toute activité politique ? N’étant pas commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’accomplissement d’une mission politique, l’agression du leader du JEF JEL ne sort-elle pas alors du champ d’application de la loi d’amnistie? Des juristes libéraux ont eu à soutenir, à juste titre au demeurant, que tous les actes et agissements d’un leader politique ne sont pas ipso facto des actes politiques. Il y en a qui relèvent du droit commun. En suivant cette même logique, l’on peut soutenir que la tentative d’assassinat ou même l’assassinat d’un leader politique n’est pas inéluctablement une infraction politique. Dans un avis rendu à propos du champ d’application de la loi d’amnistie votée par l’Assemblée nationale en application de la Constitution de la transition, la Cour suprême de justice de la République Démocratique du Congo a considéré l’assassinat du Président Laurent Désiré KABILA comme un crime de droit commun, alors même qu’il a eu lieu dans son bureau et à l’occasion de l’exercice de sa fonction présidentielle. Que penser alors de la tentative d’assassinat de Monsieur Talla SYLLA intervenue à une heure avancée de la nuit, alors qu’il sortait d’un restaurant comme tout citoyen a la droit de le faire, et pour des paroles d’une chanson?
Pour en revenir à la loi EZZAN, le Conseil constitutionnel a donné crédit à la motivation officielle contenue dans l’exposé des motifs de la loi d’amnistie fondée sur « l’exploitation de ce crime crapuleux qui réveille des souvenirs douloureux pour la famille et les proches du défunt ». L’article 2 de la loi d’amnistie profitant essentiellement à la famille de Babacar SEYE qui a droit au respect de son nom, de son intimité et de sa dignité, le juge l’a déclaré anticonstitutionnel pour détournement de procédure. En suivant le raisonnement du juge, l’impression se dégage que les assassins de Babacar SEYE ainsi que les commanditaires de ce crime ne tireraient pas profit d’une loi qui serait votée pour préserver les intérêts subjectifs d’une famille, et non d’un martyr de la démocratie sénégalaise.
Q.La majorité libérale a prolongé unilatéralement le mandat des députés d’un an. Que pensez-vous de tout cela ?
R. C’est un précédent extrêmement dangereux pour la survie de la République qui, rappelons-le, repose essentiellement sur l’élection comme mode de dévolution du pouvoir et de renouvellement des légitimités. Retirez l’élection de la République et vous vous retrouvez alors dans une monarchie ! Sauf en cas de circonstances imprévisibles et irrésistibles, le renouvellement périodique des mandats des gouvernants ne doit pas être remis en cause pour des raisons liées à la conjoncture politique, économique ou aléas climatiques. Ce grave précédent pourrait à l’avenir inspirer un autre leader politique se trouvant dans les mêmes conditions. Des économies budgétaires, modestes par rapport à la masse budgétaire totale de l’Etat, et des inondations localisées- quel que soit leur degré de gravité- sont-elles des raisons pertinentes de nature à remettre en cause un calendrier électoral ? Au delà des raisons officielles invoquées par le pouvoir, d’autres, officieuses, peuvent être mises en exergue, comme, par exemple, l’impréparation et les tergiversations qui entourent la confection d’un nouveau fichier électoral numérisé sur les cendres du fichier électoral qui avait permis l’alternance en mars 2000. L’occasion nous a une fois été donnée, dans un article publié dans les journaux « le Matin » et « Le Quotidien », d’attirer l’attention des acteurs politiques sur les hypothèques qui pourraient grever sérieusement l’expression transparente et apaisée des élections législatives devant normalement se tenir en avril 2006.
Faut-il le rappeler, la durée du mandat des députés au Sénégal est fixée par l’article 60 de la Constitution du 22 janvier 2001. Constitutionnellement, ce mandat peut faire l’objet d’abrègement dans les cas suivants : dissolution de l’Assemblée nationale, décès, démission, empêchement définitif ou démission du député de son parti. Ce sont les seuls cas de figure envisagés par le Constituant pour toucher à la durée du mandat des députés dans un sens ou dans un autre. Donc, c’est par un véritable coup de force, qu’une loi abusivement qualifiée de loi constitutionnelle a été votée mécaniquement par la majorité libérale pour imposer un couplage des élections législatives et de la présidentielle de 2007. Ayons présent à l’esprit que c’est le secrétaire général du PDS, l’actuel président de la République, qui, au cours des travaux de la Commission cellulaire pour la réforme du code électoral de 1991, avait fait accepter consensuellement l’idée de « désaccoupler » les élections législatives et présidentielles dès lors que l’Assemblée nationale et le président de la République procédaient de deux légitimités distinctes.
Pour en revenir à la loi portant prorogation du mandat des députés, l’opposition parlementaire avait saisi le Conseil constitutionnel d’un recours visant à déclarer non-conforme à la Constitution cette « loi constitutionnelle », qui, en droit, ne l’était pas réellement. En effet, tous les juristes admettent que la loi constitutionnelle n’est pas une catégorie juridique autonome à l’instar de la loi organique ou de la loi simple. La loi constitutionnelle, une fois votée conformément à la procédure prévue à cet effet par le Constituant, s’intègre dès sa promulgation dans le texte même de la Constitution qu’elle modifie en y ajoutant ou en en retranchant certaines dispositions. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel, dans sa décision d’incompétence, a expressément déclaré que la loi constitutionnelle vise à inscrire dans le texte de la Constitution des dispositions expresses ou implicites (sic !). Cela veut dire, encore une fois, qu’on devrait trouver une trace de la loi constitutionnelle prolongeant le mandat des députés dans le corps même de la Constitution du 22 janvier 2001. Ce qui n’est pas le cas dans la mesure où l’article 60 de la Constitution est resté inchangé. Ce n’est donc pas parce que la loi a été votée conformément à la procédure de révision constitutionnelle qu’elle est constitutionnelle. Le législateur peut, à ce niveau, opérer un véritable détournement de procédure, car, en réalité, cette nature constitutionnelle est appréciée a posteriori, en aval du processus, une fois la disposition formellement intégrée dans le corpus constitutionnel.
A nos yeux, le débat doit être redimensionné à la lumière de la décision d’incompétence à connaître de la loi constitutionnelle rendue par le Conseil constitutionnel. Il faut rendre justice à ce dernier qui n’a jamais validé la conformité à la Constitution de la loi en question se bornant simplement à décliner son incompétence. Ce qui doit nous amener, au vu de la jurisprudence et de la pratique en cours dans certaines démocraties (RFA, Italie, Autriche, Bénin…), à souhaiter l’instauration d’une véritable Cour constitutionnelle qui disposerait d’une compétence générale pour connaître de toutes les violations de la Constitution par le législateur, quelle que soit la forme juridique de l’acte par lequel il s’exprime (loi, résolution, décision de sanction des députés…). Ce problème de prolongation du mandat des députés s’était posé dans les mêmes termes au Bénin et là, la Cour constitutionnelle de ce pays s’était non seulement déclarée compétente mais avait jugé la loi inconstitutionnelle, là où le Conseil de chez nous a interprété restrictivement ses compétences pour ne pas aller plus loin.
La situation qui prévaut actuellement au Sénégal relève d’une sorte de « schizophrénie juridique ». L’opportunité pour certains des députés de l’opposition (MM. Moustapha NIASSE, Abdoulaye BATHILY et Madior DIOUF) de constater l’expiration de la législature en se fondant sur la Constitution, face à d’autres députés justifiant la prolongation de leur mandat par le vote d’une loi républicaine, ne s’apprécie nullement au regard des principes fondamentaux du droit constitutionnel, mais à la lumière de la conjoncture politique dans un système politique complètement déréglé du fait des initiatives intempestives et malheureuses d’un pouvoir libéral apparemment nullement pressé de solliciter le suffrage des électeurs.
Q. L’actualité parlementaire a été également rythmée par la mise en accusation du Premier ministre Idrissa SECK par la majorité libérale. Quelle lecture juridique peut-on faire d’un tel événement ?
R. Là également, les règles constitutionnelles ont été bafouées et carrément piétinées, c’est le cas de le dire, par la majorité libérale. Il convient, en passant, de relever – pour le déplorer- la fâcheuse tendance du pouvoir libéral à utiliser les moyens de l’Etat pour résoudre des différends internes au parti au pouvoir. C’est un secret de polichinelle que le Premier ministre SECK avait légitimement des ambitions présidentielles qui dérangeaient le Chef de l’Etat et son entourage direct, dans un moment où ses rapports avec son mentor s’étaient complément dégradés suite à son limogeage de la primature. Qui plus est, son fameux CD n°1 contribuait à démystifier le pouvoir libéral en livrant à l’opinion des informations tout à fait pertinentes mettant en lumière la perception que les libéraux se faisaient du pouvoir qui leur offrait des ressources extraordinaires leur permettant de mettre fin pour longtemps à leurs soucis d’argent. Toutefois, et c’est le revers de la médaille, le pouvoir est également le centre de manœuvres, de conspirations, de luttes fratricides, voire même de règlements de comptes car, comme l’a fait ressortir le CD, « les grands bandits ne se battent qu’au moment du partage du butin » (sic).
Sur le strict plan de la conformité à la Constitution de la résolution de mise en accusation du Premier ministre SECK, il y a lieu de regretter le véritable coup de force de la majorité libérale et de ses alliés qui ont eu une lecture en réalité infondée de ce qu’est la majorité qualifiée. La Constitution est sans équivoque : la résolution est votée par la majorité des 3/5 des membres composant l’Assemblée nationale. Cette majorité ne se détermine pas par rapport au nombre de députés présents au moment du vote, mais par rapport au nombre des députés composant l’Assemblée nationale (en principe 72 députés sur 120).
Il est vrai que la loi organique sur la Haute Cour de Justice exclut des votants les députés membres de la Haute Cour de Justice, sans envisager, comme le fait la loi française sur la Haute Cour de Justice, une mesure de compensation précisant clairement que ce nombre correspondant à celui des députés siégeant à la Haute Cour de Justice est déduit du nombre total des députés composant l’Assemblée nationale.
A titre d’illustration, je renvoie les observateurs aux dispositions constitutionnelles relatives à la recevabilité des amendements ou des propositions de loi de nature financière. Au Sénégal par exemple, de tels amendements ou propositions sont recevables dès lors qu’ils ont été assortis de mesures compensatrices, alors qu’en France ils sont irrecevables mêmes s’ils sont accompagnés de mesures compensatrices. En conséquence, dans le cadre du vote de la résolution de mise en accusation, la loi française a bien envisagé des mesures compensatrices là où la loi sénégalaise s’est gardée de le faire. Aussi, la résolution adoptée par une majorité inférieure aux 3/5 des membres composant l’Assemblée nationale viole expressément la Constitution, alors que dans le cas du Premier ministre SECK, elle a été suivie d’effet.
Le paradoxe est que le recours éventuellement porté devant le Conseil constitutionnel visant l’annulation de cette résolution qui affecte gravement les droits constitutionnels de Monsieur SECK, allait de toute façon être rejeté par le Conseil constitutionnel, sous le motif qu’il ne connaît que de la constitutionnalité des lois parlementaires et non des résolutions, alors qu’une véritable Cour constitutionnelle serait compétente pour connaître d’un tel recours afin d’éviter tout déni de justice.
Entretien réalisé par M. Ibrahima Mané, Journaliste politologue au "TEMOIN"